Interview de Roger Chartier

Roger Chartier est professeur émérite au Collège de France, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) et Annenberg Visiting Professor à l’Université de Pennsylvanie. Son domaine d’étude est la culture écrite à l’époque de la première modernité (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles) : histoire des textes, de l’édition et de la lecture.
Il sera au Portugal du 26 au 30 mai, où il participera à plusieurs rencontres autour du livre, de l’histoire et de la pensée:
- Lundi 26 mai | 18h00 | Bibliothèque nationale du Portugal
Participation au lancement de la revue Electra
Avec Antonio Guerreiro et Diogo Ramada Curto
- Mardi 27 mai | 9h30 | Académie des sciences de Lisbonne
Conférence inaugurale “Cervantes ou l’importance des Classiques” suivie de la table ronde “L’actualité des classiques : Cervantès et Camões”
Avec Isabel Almeida, Henrique Leitão et José Bernardes
Colloque “Camões et les sciences”
- Jeudi 29 mai | 19h00 | Nouvelle Librairie Française
Cycle de conférences “Et si l’on parlait de… livres et de lecteurs”
Dialogue entre Roger Chartier et Alberto Manguel
- Vendredi 30 mai | 19h00 | Médiathèque de l’Institut français du Portugal
Présentation de la traduction portugaise de Ouvir os mortos com os olhos de Roger Chartier (éd. Tinta-da-China)
Avec Roger Chartier et Rui Tavares
Avant son arrivée, Guillaume Boccara, attaché de coopération universitaire et scientifique à l’Institut français du Portugal, est allé à sa rencontre. Ensemble, ils ont échangé sur l’histoire culturelle, la matérialité du livre, les nouveaux modes de lecture et la notion d’auteur.
Guillaume Boccara :
Cher professeur Roger Chartier vous serez très prochainement au Portugal (cf. programme online) pour une série d’activités (conférences, séminaires, tables rondes) entre Lisbonne et Coimbra. Votre œuvre, riche et originale, porte sur l’histoire du livre et de la culture écrite. Elle s’inscrit dans une histoire qui ce veut tout à la fois sociale et culturelle. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que ce que l’on entend par histoire culturelle ?
Roger Chartier : Définir l’histoire culturelle de manière tranchée et unique n’est pas aisé parce que la définition de culture est elle-même problématique. La culture peut, en effet, être comprise comme le domaine propre des créations intellectuelles et artistiques, soit comme l’ensemble des symboles, des conceptions et des pratiques qui organisent les relations des communautés et des individus avec le monde social, la nature ou le sacré. Le propre de l’ « histoire culturelle » réside sans doute dans l’articulation entre ces deux définitions. De là, sa double dimension, à suivre Carl Schorske : situer chaque œuvre intellectuelle ou esthétique dans sa relation avec celles qui l’ont précédée (imitation, parodie, rupture) et l’inscrire dans l’ensemble des représentations et des expériences sociales qui construisent ses significations. Une telle perspective permet de déplacer ou d’effacer les frontières délimitant de manière trop rigide et cloisonnés différentes histoires : histoire des idées, histoire de l’art, histoire de l’éducation, etc. Une telle perspective prend sens dans l’étude d’objets particuliers : une œuvre littéraire, philosophique ou artistique, les modalités de publication et de circulation des textes ou des images, une pratique sociale – par exemple la lecture.
Guillaume Boccara :
Vous êtes connus et internationalement reconnus pour les recherches que vous menez depuis plusieurs décennies sur l’histoire du livre ou, pour reprendre vos propres termes, sur l’histoire « des formes et des supports de l’écriture et les manières de lire » ainsi que sur « les formes qui confèrent leur existence aux livres et les appropriations qui les investissent de sens » ( cf. Écouter les morts avec les yeux, Leçon inaugurale au Collège de France prononcée en 2007 traduite et publiée chez l’éditeur portugais Tinta-da-China en mai 2025). Pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure la matérialité et les diverses formes du livre sont tout à fait capitales pour saisir le rôle qu’ont joué la culture écrite et la lecture dans l’histoire, et notamment dans de la construction des États, des bureaucraties et de la sphère publique ? Car on s’intéresse plus volontiers au contenu d’un livre qu’à sa matérialité. Et vous nous dites : attention ! « rouleau », « codex » « livre numérique », ce n’est pas le même chose…
Roger Chartier : Les œuvres semblent traverser le temps en demeurant toujours identiques à elles-mêmes. Hamlet est Hamlet pour tous ceux qui au fil des siècles ont vu, lu, joué ou commenté la pièce. Pourtant, la rencontre avec cette pièce a toujours été produite par sa lecture dans une édition particulière, son écoute dans une mise en scène spécifique, sa découverte dans une langue qui n’est pas nécessairement celle du dramaturge. David Scott Kastan a désigné comme « platonicienne » la conception qui considère que les œuvres transcendent toutes leurs possibles incarnations et comme « pragmatiques » les relations étroites nouées entre la construction de la signification des œuvres et les formes de leur publication.
Pour moi mobilité des textes et matérialité des œuvres sont étroitement liées et nous obligent à considérer cinq raisons qui produisent la pluralité des textes d’une même œuvre : le régime de leur attribution, entre nom d’auteur et anonymat ; leurs variantes textuelles d’une édition à l’autre ; les formes matérielles de leur publication et de leur circulation, les migrations d’une « même » œuvre entre genres et entre langues ; enfin les attentes, modalités et pratiques de leurs lectures.
Tous les textes, littéraires ou techniques, religieux ou administratifs, scientifiques ou philosophiques, ont été transformés, à des degrés divers, par ces variations. C’était là la raison d’être de ma chaire au Collège de France et l’objet même de mes recherches publiées ou en cours.
Guillaume Boccara :
Dans cette même Leçon inaugurale de 2007 dans laquelle vous énoncez ce qui allait être votre programme de recherche dans le cadre de la Chaire « Écrit et cultures dans l’Europe moderne », vous observez que si la lecture a déjà connu plusieurs révolutions, notamment du passage du rouleau au codex, celle que nous connaissons aujourd’hui avec numérique et livre électronique tend à opérer des changements sans précédent. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, vous nous dites que la lecture face à l’écran « n’est pas la lointaine héritière des pratiques permises et suscitées par le codex » ! Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la textualité numérique présente des défis radicalement nouveaux qui tendent à changer en profondeur nos façons de lire, de nous émouvoir à travers la lecture, d’entrer en relation avec les autres et, dernière chose et non des moindres, de concevoir la notion même d’auteur/e ?
Roger Chartier :
En rompant l’ancien lien entre le texte et l’objet dans lequel il est inscrit, entre les discours et leurs matérialités propres, le monde numérique impose une révision radicale des gestes et des notions que nous associons à l’écriture. Il ne faut pas sous-estimer l’originalité de notre présent. Les différentes transformations de la culture écrite, qui dans le passé étaient toujours séparées, se présentent simultanément dans l’univers numérique. La révolution de la communication électronique est à la fois une révolution de la technique de production et de reproduction des textes, une révolution de la matérialité et de la forme de leur support, ainsi qu’une révolution des pratiques de lecture. Une nouvelle écologie de l’écriture s’est ainsi établie, caractérisée par plusieurs traits.
Le premier est l’usage du même support pour lire et écrire. Dans le monde pré-numérique, les objets destinés à la lecture de textes imprimés (livres, revues ou journaux) étaient séparés de ceux destinés à l’écriture personnelle (feuilles, carnets, lettres). Dans le monde électronique, c’est sur le même écran que se combinent étroitement les deux pratiques des nouveaux « wreaders », lecteurs qui écrivent et écrivains qui lisent.
Un deuxième trait du monde numérique est l’établissement d’une continuité morphologique entre les différentes catégories de discours : messages des réseaux sociaux, informations de sites web, livres ou articles électroniques. Ainsi disparaît la perception de leur différence par leur matérialité propre. Cette continuité efface les procédés traditionnels de la lecture, qui supposent à la fois la compréhension immédiate, grâce à la forme de publication, du type de savoir ou de plaisir que le lecteur peut attendre d’un texte, et la perception des œuvres en tant qu’œuvres, dans leur identité, leur totalité et leur cohérence.
D’où un troisième trait : à la surface lumineuse de l’écran apparaissent des fragments textuels sans que l’on puisse immédiatement percevoir les limites et la cohérence du texte ou du corpus (livre, numéro de revue ou de journal) dont ils sont extraits. La lecture discontinue, fragmentée, des textes numériques donne ainsi autonomie aux fragments, transformés en unités textuelles décontextualisées.
C’est pourquoi il faut convaincre les institutions, les pouvoirs publics et les lecteurs d’aujourd’hui que les différentes formes d’inscription, de publication et d’appropriation des écrits ne sont pas équivalentes et que, par conséquent, aucune ne peut ni ne doit se substituer entièrement aux autres.
Avec l’intelligence artificielle générative, ce sont les concepts fondamentaux de la culture écrite, définis à partir du XVIIIᵉ siècle par le lien entre originalité des œuvres, responsabilité de l’auteur et propriété intellectuelle, qui se trouvent menacés. Le monde de l’IA est caractérisé par la disponibilité publique des écrits, par l’anonymat de l’écriture automatique et par la réutilisation ou le plagiat de textes déjà écrits. Ainsi, la révolution des agents conversationnels n’est pas seulement une révolution technique de l’accès à l’information (comme l’ont été l’apparition de l’écriture, l’invention de l’imprimerie ou la révolution d’internet), mais aussi une rupture radicale avec les catégories les plus essentielles qui ont construit notre ordre des discours.
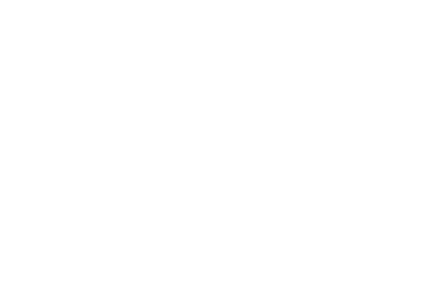
 Débat d'idées
Débat d'idées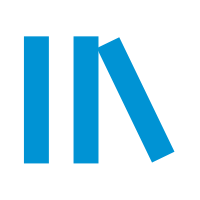 Livre
Livre


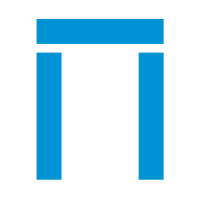 Architecture
Architecture Arts visuels
Arts visuels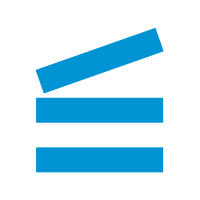 Cinéma
Cinéma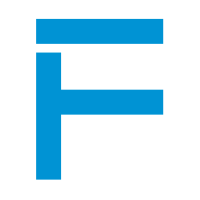 Français
Français Institutionnel
Institutionnel Musique
Musique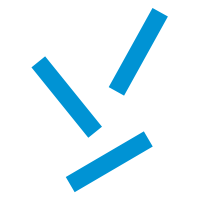 Non classifié(e)
Non classifié(e) Numérique
Numérique Spectacle vivant
Spectacle vivant